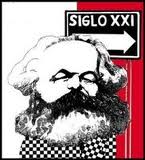Le coup d’État qui a eu lieu en Bolivie à la mi-novembre 2019 a été le résultat d’une série d’épisodes violents depuis les élections présidentielles du 20 octobre 2019. La complicité par omission des forces armées avec les putschistes, la démission d’Evo Morales précipitée par la « suggestion » des militaires de le faire, et le comportement ultérieur de la police et de l’armée contre le peuple bolivien, ont attiré l’attention sur le modèle politique appelé « Socialisme du XXIème siècle » et sa mise en œuvre dans Notre Amérique.
Le coup d’État qui a eu lieu en Bolivie à la mi-novembre 2019 a été le résultat d’une série d’épisodes violents depuis les élections présidentielles du 20 octobre 2019. La complicité par omission des forces armées avec les putschistes, la démission d’Evo Morales précipitée par la « suggestion » des militaires de le faire, et le comportement ultérieur de la police et de l’armée contre le peuple bolivien, ont attiré l’attention sur le modèle politique appelé « Socialisme du XXIème siècle » et sa mise en œuvre dans Notre Amérique.
Londres, 28 septembre 1864: naissance de l’Association International des Travailleurs (“Première Internationale”) durant un meeting de solidarité avec la lutte du peuple polonais contre l’oppression tsariste
Il faut d’abord clarifier l’utilisation du terme socialisme au cours des 150 dernières années. Dénoncés et loués à divers moments de l’histoire, il convient de rappeler que de nombreux partis socialistes ou sociaux-démocrates, membres de la Deuxième Internationale, ont soutenu leurs bourgeoisies respectives pendant la Première Guerre mondiale, à l’exception du Parti ouvrier social-démocrate russe, qui s’est opposé à une entreprise aussi insensée et a récolté les fruits d’une décision aussi sage en octobre 1917. Quelques années plus tard, la Troisième Internationale Communiste a décrit comme une hérésie le parti portant le « nom de famille » de socialiste, c’était une des raisons pour lesquelles le Parti Socialiste Révolutionnaire (PSR) en Colombie a été mal vu par certains dirigeants communistes à Moscou, qui se fixaient sur le nom et non sur ce que faisait une organisation politique aussi combative.
Le terme socialiste a été utilisé même par les nazis, le parti ouvrier national-socialiste allemand était le nom adopté par les partisans d’Hitler. Mais certains héritiers de la Deuxième Internationale ont fondé l’Internationale ouvrière et socialiste (IOAS) en 1923, se différenciant de la Troisième Internationale communiste. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs partis socialistes, sociaux-démocrates et le parti travailliste anglais « ont fondé l’Internationale socialiste en juin 1951 à Francfort, se qualifiant de « socialisme démocratique » et critiquant « à la fois le ” capitalisme débridé” et le “communisme soviétique” en tant que “nouvel impérialisme”. Elle affirme que le socialisme veut construire une société “libre et démocratique”, cherchant à remplacer le capitalisme par un système où les intérêts publics priment sur les intérêts privés, entre autres choses »[1].

Il est donc clair que ce courant du socialisme se constitue comme alternative au “capitalisme débridé” ou ” capitalisme sauvage ” selon les termes d’aujourd’hui, mais il le fait sans remettre en cause l’essence de tout capitalisme : d’une part, l’enrichissement d’une classe et l’appauvrissement des autres, et d’autre part, le monopole du pouvoir coercitif de l’État en faveur de la ou des classes dominantes. Le meilleur exemple de ce type de parti est le Parti socialiste ouvrier espagnol. En exil pendant la dictature franquiste (1939-1975), il était pratiquement invisible pendant les dures années de résistance au dictateur, mais à l’aube de la “démocratie post-franquiste”, il a renoncé au marxisme et avec le soutien de millions de l’Internationale socialiste, il est devenu le parti au pouvoir qui a neutralisé la puissante influence du Parti communiste, qui n’avait pas pris le chemin de l’exil et avait servi les luttes ouvrières et sociales pendant la longue nuit fasciste.
Après la crise du socialisme réel et la défaite d’une grande partie de la gauche armée en Amérique latine, une nouvelle catégorie s’est établie dans la région : « Le socialisme du XXIème siècle ». Son créateur, le sociologue germano-mexicain Heinz Dieterich Steffan, fait une proposition apparemment novatrice : « Relire l’histoire de l’économie politique, parce qu’à son avis, certaines d’entre elles ne parviennent pas à se manifester en raison de la confusion conceptuelle dans cette discipline : la première, qui s’est produite tout au long des deux cents dernières années, a identifié le capitalisme avec le libéralisme ; la seconde, qui s’est produite au cours de ce siècle, a identifié le socialisme avec l’étatisme. Sa thèse est que la manière la plus rapide d’atteindre la société la plus juste est obtenue par une alliance entre le socialisme et le libéralisme, une fois que le socialisme a laissé de côté l’étatisme et que le libéralisme a laissé de côté le capitalisme »[2] . Le terme en question a pris sa force à partir des discours d’Hugo Chávez et en Colombie il a été attribué aux politiciens de la “gauche démocratique”.
Alvaro Hamburger, reprenant les propos de Marta Harnecker, souligne que, d’un point de vue doctrinal, le Socialisme du XXIème siècle a pour objectif de ne pas commettre les erreurs du Socialisme réel (soviétique) du 20ème siècle. « Le terme a été forgé par Hugo Chavez pour le différencier des erreurs et déviations du « socialisme réel » du XXème siècle en Union soviétique et dans les pays d’Europe de l’Est. La principale leçon du projet chaviste est la nécessité et l’importance de combiner le socialisme avec la démocratie, non pas une démocratie libérale, mais une démocratie participative et directe »[3].

Chávez, le Christ et Bolivar dans un mural vénézuélien
Plusieurs intellectuels ont tenté de le définir. Rafael Díaz-Salazar et Juan Carlos Monedero s’identifient à Marta Harnecker, qui “propose quelques “traits du socialisme du XXIème siècle” dans une perspective latino-américaine. Ces caractéristiques sont essentiellement au nombre de cinq, à savoir : l’homme en tant qu’être social, un développement humain complet, une démocratie participative et protagoniste, un nouveau modèle économique et un degré élevé de décentralisation qui permet un véritable protagonisme populaire »[4]. L’organisation populaire pour la défense des droits acquis brille par son absence.
En Équateur, Rafael Correa l’a assumé catégoriquement pendant son mandat. Alberto Acosta, ancien ministre et ancien président de l’Assemblée nationale équatorienne en 2007, considérait que le « socialisme du XXIème siècle » était celui qui n’avait pas « ses réponses enracinées dans des manuels. Nous ne partons pas de visions dogmatiques. Si nous réussissons à établir un manuel, ce sera avec la possibilité de changer les pages à chaque fois que ce sera nécessaire. Ce sera pour la corriger constamment, car nous ne pouvons pas croire en la vérité définitive. Nous devons faire un exercice de construction démocratique permanente. C’est ainsi que le socialisme du XXIIème siècle devrait être construit »[5].
Correa a souligné : « Nous sommes pour une révolution citoyenne, de changement radical, profond et rapide des structures politiques, sociales et économiques »[6]. La situation actuelle en Équateur et le virage à 180° opéré par Lenin Moreno, vice-président pendant le mandat de Correa et censé poursuivre son travail, en disent long sur les véritables changements structurels apportés par le “socialisme du XXIème siècle” dans ce pays et aux nombreuses pages qui devront être changés à ce modèle, pour reprendre les termes d’Alberto Acosta.
La vague de victoires électorales progressistes en Amérique latine au cours de la première décennie du XXIème siècle a enthousiasmé beaucoup de gens, dans certains cas leurs citoyens ont pu recevoir de l’État le minimum de droits fondamentaux qui, pendant des siècles, avaient été niés par les oligarchies de leurs pays. L’impact a été tel que beaucoup ont parlé de révolution et de socialisme, mais il s’avère que les classes dominantes sont restées intactes, dans de nombreux cas en gagnant de l’argent grâce aux contrats de l’État, et, ça oui, en développant l’opposition la plus féroce et la plus illégale aux nouveaux administrateurs de l’Etat, et en reproduisant également les mensonges et l’arrivisme à travers leurs médias. Le journaliste uruguayen Raúl Zibechi est très critique à l’égard des gouvernements dits progressistes en Amérique latine. Il reconnaît que l’augmentation des revenus des plus démunis a permis d’élever le niveau de vie, mais par le biais de la consommation et en ayant pour intermédiaire le système financier, qui s’est bien sûr enrichi, comme dans le cas du Brésil de Lula, pour ne citer qu’un exemple[7].
Or, l’Etat-providence, ou mieux, celui qui garantit les droits fondamentaux de la population, est relativement coûteux ; les ressources doivent venir de quelque part, et comme les élites traditionnelles ne sont pas substantiellement affectées, il faut recourir à l’exploitation des ressources naturelles, ce qui se heurte parfois aux intérêts des communautés indigènes qui ont une vision du développement du bien-vivre, en équilibre avec la “mère terre”, ce qui rend difficile le financement du “socialisme du XXIème siècle”. Un exemple : le conflit du gouvernement bolivien pour le contrôle de la région de Chiquitanía, qui est passée aux mains des propriétaires terriens brésiliens et à partir de laquelle le coup d’État contre le président Lugo au Paraguay a été organisé[8].
Ensuite, il y a la gestion du système financier mondial dans lequel le dollar reste la principale monnaie pour les transactions internationales, ses circuits restent entre les mains du capitalisme, dont il est très difficile de se séparer. La question est encore compliquée par le fait que la Bolivie a eu recours à des prêts internationaux de 10,177 milliards de dollars au 31 décembre 2018[9], ce qui indique que la croissance économique a été subventionnée par la dangereuse voie de l’endettement extérieur.
En termes d’organisation, la participation indigène dans le pays andin a été folklorisée, c’est-à-dire beaucoup de jupes bouffantes et de chapeaux ronds, mais dans la pratique, des relations sociales bourgeoises au sein de l’élite socialiste.
En fin de compte, dans l’ensemble des sociétés où les valeurs bourgeoises continuent d’être hégémoniques, les nouveaux dirigeants sont devenus une fraction du bloc dominant qui sauve le pays des catastrophes néolibérales, non exempte du “doux miel de la corruption”. Bien qu’on ne puisse ignorer deux aspects qui la différencient de l’oligarchie traditionnelle : d’une part, l’investissement social et la prise de conscience de vastes secteurs de la population, et d’autre part, l’éloignement des USA et l’alliance avec les nouvelles puissances (Russie et Chine), comme expression d’un ordre multipolaire.
Les gouvernements socialistes ou même dits progressistes, à l’exception du Venezuela, qui avait déjà des forces armées de gauche et a opportunément armé le peuple, et du Nicaragua, qui a d’une certaine manière repris son héritage insurgé, ont laissé l’échafaudage militaire intact, jusqu’à récemment gardien fidèle de la doctrine de sécurité nationale et bourreau cruel de son propre peuple. Bien sûr, ces organes ne se modifient pas du jour au lendemain, mais la création de nouvelles institutions armées qui garantissent la sécurité et la souveraineté du peuple est une tâche urgente, immédiate, mais complexe et difficile, puisque les oligarchies et les gringos s’y opposeront, au prix même de susciter une guerre civile, puisqu’ils savent que ces nouvelles entités seront leurs fossoyeurs ; la question est de savoir quand il est plus facile de construire des outils de ce type, en étant au gouvernement ou dans l’opposition ?

“13 ans passés à transformer la Bolivie”
Le cas bolivien illustre cette réconciliation des classes, qui devient tôt ou tard tragique. Evo Morales et le Mouvement vers le Socialisme ont sans aucun doute réalisé la meilleure gestion de l’histoire bolivienne au cours de leurs 13 années de mandat ; tant sur le plan social, économique que structurel, les données parlent d’elles-mêmes, nous ne les répéterons pas. Il est clair que Morales n’a pas armé son peuple pour des batailles stratégiques, un mode de fonctionnement bourgeois au sein de l’élite socialiste a considéré qu’ils avaient des forces suffisantes pour continuer avec l’exécutif pour une autre période après les élections, apparemment ils avaient raison, seulement ils n’ont pas tiré de leçons du soulèvement de l’oligarchie de Santa Cruz peu après l’installation d’Evo au pouvoir à la fin de la décennie précédente, ni d’Allende en 1973. Leur attitude conciliante, avec une élite et des forces armées parmi les plus rétrogrades et meurtrières d’Amérique latine, lui a fait croire que l’alliance armée-paysannerie durerait. On pourrait qualifier de secondaire ce qui s’est passé avec la “carambole” légale qui a permis à Evo une quatrième réélection, après qu’en 2016, lors d’un plébiscite, 51% des citoyens eurent dit NON ; l’ambassadeurice de Bolivie en Iran dit, dans une interview télévisée[10], qu’Evo a respecté le résultat du plébiscite, mais qu’après un an la loi bolivienne permet au juge constitutionnel de se prononcer à nouveau sur le sujet, parce que nous parlons d’un droit fondamental ; ensuite, le gardien suprême de la loi a décrété que Morales, OUI, avait le droit d’être élu à nouveau ; un argument trivial, puisque la majorité de la population, après trois périodes de gouvernement, lui avait dit qu’elle ne voulait plus de lui, qu’elle voulait donner ce droit à quelqu’un d’autre ; face à cette collision, les droits de 51% des électeurs devraient primer sur les droits d’une personne. Certains juges ont donné à Morales la possibilité d’un nouveau mandat en 2017, d’autres juges, soudainement les mêmes, il y a quelques semaines, ont reconnu l’usurpatrice Añez, à qui un militaire a mis l’écharpe présidentielle. Je le répète, l’affaire est apparemment secondaire, mais elle a donné sur un plateau d’argent un excellent argument pour lancer le coup d’État organisé depuis un bon moment et discréditer le “socialisme du XXIème siècle”.
Une citation de Régis Debray vient à l’esprit :
« On n’est pas un réformiste en appliquant des réformes au lieu de “faire la révolution”. On est réformiste si l’on imagine que les réformes ne conduiront pas un jour à une situation révolutionnaire et que les mêmes méthodes qui permettent d’appliquer les réformes permettront aussi de résoudre une situation de crise révolutionnaire, dans laquelle ce qui est en jeu n’est plus la modification d’un article de la Constitution ou du nombre exact d’entreprises à nationaliser, mais la vie ou la mort, la défaite ou la victoire de l’un des deux camps en présence »[11].
« Une situation révolutionnaire n’est pas une situation qui met “la révolution” à portée de main, comme un beau fruit mûr qu’il suffirait de cueillir. Une situation peut être qualifiée de révolutionnaire non pas lorsque la révolution y est inévitable, mais à partir du moment où il devient inévitable de choisir entre un bond révolutionnaire en avant et un bond contre-révolutionnaire en arrière, parce que les solutions de compromis et les positions intermédiaires ne sont plus viables. Dans ce sens, toute situation révolutionnaire est aussi, et dans le même mouvement, une situation contre-révolutionnaire : la crise, indéterminable en soi, peut être décidée d’une manière ou d’une autre selon les forces en présence ou la capacité et l’esprit de décision des directions politiques opposées »[12].
Debray poursuit :
« (…) une classe dirigeante peut temporairement perdre le contrôle du processus politique apparent, en cas de défaite électorale par exemple, sans pour autant perdre le contrôle de l’État, dont le véritable centre nerveux – comme le révèlent toutes les crises politiques aiguës – est l’appareil armé de répression. Dans un moment de crise (= transformation de la contradiction en antagonisme (…) [comme s’il s’agissait] d’un duel), un gouvernement populaire sans police ni armée populaire n’a plus les moyens de gouverner, c’est-à-dire de se maintenir (…) Et c’est une illusion de volonté que de demander à l’appareil d’Etat un nouveau fonctionnement physiologique sans toucher à son anatomie »[13].
L’obéissance des forces armées aux autorités légalement constituées, quelle que soit leur idéologie, est mise à l’épreuve dans les moments de crise politique.
En conclusion, la démission de Morales de la présidence était sur le point de devenir une humiliation majeure. Il est clair que les dirigeants du coup d’État allaient le tuer, n’étant pas intéressés à un ancien président dans l’opposition et encore moins en prison. Plusieurs options s’offraient à Evo, mourir comme Allende et entrer dans l’histoire, ou mourir en fuyant comme un lâche, aux mains des fascistes, son corps aurait probablement été profané et aurait sûrement disparu (une tombe est toujours un symbole puissant). L’intervention de ses sympathisants et la solidarité internationale lui ont sauvé la vie, à un cheveu près. Sa démission et ses appels aux dirigeants du coup d’État pour qu’ils mettent fin à la violence n’ont pas apaisé la fureur prédatrice de la droite bolivienne, ils ont semé la confusion dans la population et ont fait paraître l’homme d’État faible.
La gauche qui se défend ne sera jamais bien vue par les puissants de toujours. Continuons avec Debray :
« Si (…) le socialiste contre-attaque pour se défendre, s’il surveille ses frontières et confie au peuple le soin de prendre soin de son autodéfense (comme à Cuba, les Comités pour la défense de la révolution), s’il applique à ses ennemis leurs propres méthodes, œil pour œil, dent pour dent, jusqu’à les immobiliser, il évitera la dictature bourgeoise dont la vengeance est mille fois plus horrible et sanglante que la dictature du prolétariat ; mais dans ce cas, il sera un despote totalitaire et paranoïaque, un néo-stalinien, et au nom de la liberté et des droits de l’homme, il sera insulté.. »
« Puisque, sur ce terrain, on perd toujours, il vaut mieux perdre sa réputation d’humaniste que de perdre le pouvoir et la vie. Il vaut mieux ne pas être pardonné pour son existence que d’être anobli à titre posthume »[14].
Le “Socialisme du XXIème siècle” a beaucoup à apprendre du “Socialisme du XXème siècle”. L’individualité historique, le type d’hommes et de femmes que la gauche doit produire, sont ceux qui luttent pour la transformation radicale des sociétés, de telle sorte qu’elle empêche l’existence d’opprimés et d’oppresseurs, non seulement la solidarité entre frères, très à la mode selon les mots du prêtre Frei Betto, mais qui ne cesse pas d’avoir une certaine parenté avec la charité chrétienne, est la solidarité dans le feu de la lutte !

La “construction du socialisme dans un seul pays” dans les années trente du siècle dernier, ou la “transition pacifique vers le socialisme” depuis la fin des années cinquante (dans la conviction que la contradiction entre les forces productives et les rapports de production ferait sombrer le capitalisme), étaient un terrain fertile pour que le bureaucratisme se déchaîne contre les citoyens de leur propre pays dans les pays du socialisme réel, un autre monde aurait émergé si les Soviétiques s’étaient mis à lutter contre les métropoles capitalistes et leurs alliés de la périphérie, comme l’a fait remarquer Trotsky après la mort de Lénine.
En revanche, le capitalisme, obsédé par la baisse tendancielle du taux de profit, a résolu ses crises en recourant à son essence : assassiner, voler, piller, exploiter des peuples entiers, détruisant la nature dans son sillage. Les bourgeois ont compris que la lutte des classes est le moteur de l’histoire, d’autant plus quand ils sont gagnants.
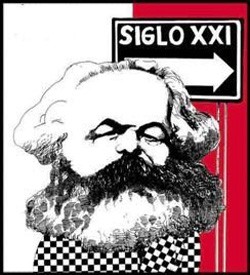
Les défaites du socialisme ont enseigné qu’il ne faut pas tout nationaliser, qu’il ne faut pas toujours avoir un parti unique, qu’il faut promouvoir des individualités remarquables dans les sphères économique, scientifique, culturelle et artistique, mais il y a des aspects essentiels qui ne peuvent être évités. Le “socialisme du XXème siècle”, a commis de nombreuses erreurs, mais il a évité les invasions et les guerres civiles, a vaincu la formidable machine de guerre nazie qui a bénéficié de la complaisance des USA pendant la Seconde Guerre mondiale, a élevé le niveau de vie matériel et culturel de centaines de millions de personnes, a construit des infrastructures durables, a été le premier à visiter l’orbite terrestre, il a duré sept décennies. Le “Socialisme du XXIème siècle” n’existe que depuis quelques années, ses résultats, bien qu’importants, sont encore contradictoires, ses fondements ne peuvent pas résister à la “gifle” d’un “putsch soft”, qui tôt ou tard deviendra un “putsch dur”.
Il est probable que grâce aux autochtones aguerris, Evo reviendra en Bolivie, espérons que lui et les autres dirigeants progressistes de Notre Amérique aient réalisé ce qui les attend, s’ils défendent vraiment le peuple jusqu’aux dernières conséquences.
Notes
[1] Declaration of the Socialist International adopted at its First Congress held in Frankfort-on-Main on 30 June-3 July 1951
[2] Dieterich, Heinz. Origen y Evolución del Socialismo del Siglo XXI. 29/03/2010.
[3] Hamburger, Álvaro. El Socialismo del Siglo XXI en América Latina: Características, desarrollos y desafíos. En: Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 9, núm. 1, enero-junio, 2014, pp. 131-154 Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia. Pg. 134
[4] Calvo, Hernando. El Presidente Rafael Correa y el Socialismo del Siglo XXI (Entrevista). 09/12/2019.
[5] Calvo, Ibid.
[6] Calvo, Ibid.
[7] Muñoz, Gloria. El saldo negativo de los gobiernos “progresistas” y la nueva presidencia de México (Entrevista a Raúl Zibechi). 10/12/2018
[8] Zelada, César. Bolivia al rojo vivo. 12/11/2019 h
[9] Los Tiempos. Deuda externa de Bolivia sube a US 10.065 millones hasta julio [de 2019]. 10/09/2019
[10] Hispantv. “Golpe de Estado en Bolivia”. Detrás de la razón (minute 30:58 à 35:22)
[11] Debray, Régis. La crítica de las armas I. Madrid: 2ª edición, Siglo XXI, 1975. Pg. 262
[12] Debray, Ibid, pg. 262, 263
[13] Debray, Ibid, pg. 252, 253
[14] Debray, Ibid, pg. 258
Jaime Jimenez
Original:
Traduit par Fausto Giudice Фаусто Джудиче فاوستو جيوديشي
Source: Tlaxcala, le 5 janvier 2020