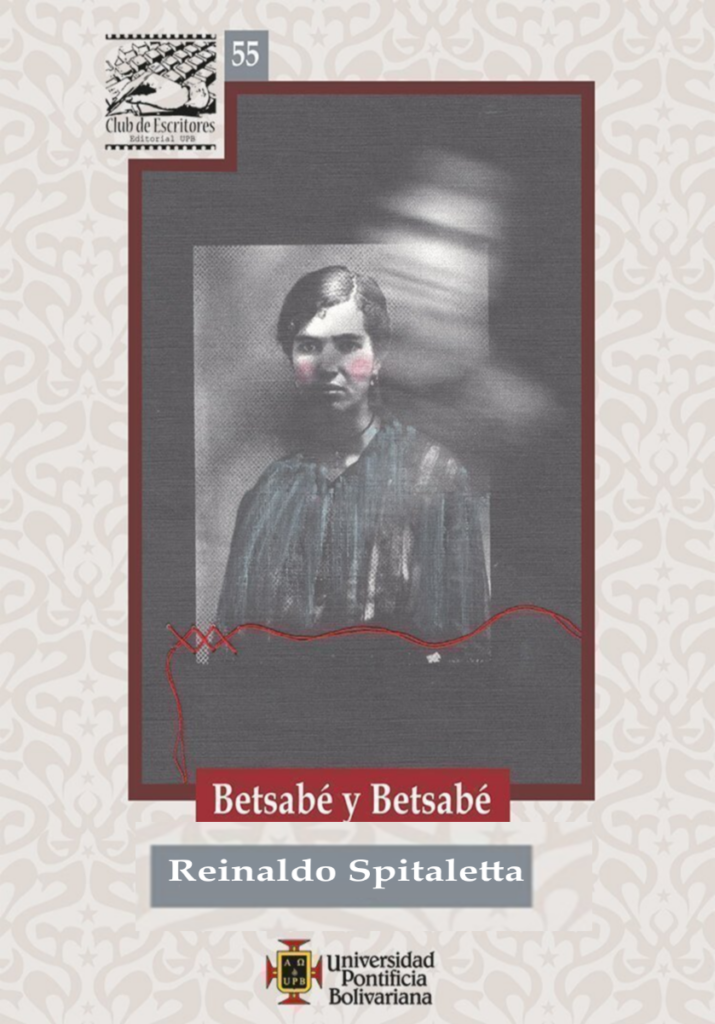Quatre cents demoiselles, tisseuses, ourdisseuses, rebelles, certaines adolescentes, d’autres encore enfants, certaines déjà « grandes », sont passées dans l’histoire de la Colombie comme les protagonistes de la première grève dans le pays, à l’aube des fameuses « années folles et heureuses ». Elles mettaient en application la loi récente, n° 78 de novembre 1919, qui consacrait le droit de grève, à une époque où artisans (tailleurs, cordonniers), ouvriers, mineurs, cheminots avaient déjà fait entendre leur voix de protestaation et mené des grèves contre deivers abus en matière de travail.
Mais ce sont les travailleuses de la Fabrique de Tissus de Bello (qui eut d’autres raisons sociales) qui, avec leur grève de vingt et un jours (commencée le 12 février 1920), furent inscrites dans l’histoire de la dignité et des combats prolétariens. Betsabé Espinal, leur principale dirigeante, était une « petite négresse futée », jolie, fille « naturelle » de Celsa Julia Espinal, et avec un caractère et une personnalité redoutables pour remettre à leur place les patrons de l’usine et trois contremaîtres, qui faisaient chanter et persécutaient les ouvrières.
Les filles de la boîte (première usine du secteur fondée dans la Vallée d’Aburrá) se soulevèrent contre la tyrannie du gérant Emilio Restrepo Callejas, alias Paila, dont, des années avant le formidable déclenchement de la grève, Carlos E. Restrepo (un autre actionnaire de l’entreprise) s’était plaint de l’autoritarisme et de l’arrogance, et contre les manœuvres grossières de trois contremaîtres qu’elles avaient baptisés « caciques ».

La rébellion des « petites pucelles très pures » répondait aussi à d’autres saloperies, comme les longues journées de travail (« du lever au coucher du soleil») et l’interdiction de garder leurs chaussures au travail, à une époque où déjà les discours hygiénistes promulguaient la nécessité de chaussures dans la prévention des maladies, et où, par exemple, à Medellín, il y avait déjà des usines qui en fabriquaient, comme celle appelée Roi Soleil. L’étrange déclenchement d’une grève, outre des ouvrières « pures et chaste » (l’usine employait aussi une centaine d’ouvriers mâles, dont beaucoup agirent comme briseurs de grève), a provoqué une « couverture » par les journaux et les magazines, ainsi que la solidarité de larges secteurs de la population.
Des reporters d’ El Espectador (comme celui qui signait Le Curieux impertinent), d’ El Luchador (journal socialiste), d’ El Correo Liberal, de La Defensa, d’El Social et d’autres, ont « couvert » l’événement insolite, en un temps où l’Église catholique faisait la promotion du « modèle marial » et des « reines du foyer », et autres modèles de femmes et où, en tout cas, on n’aurait jamais pensé qu’elles pourraient entreprendre une tâche énorme comme une grève, étant en outre des « demoiselles ». Parce que c’était une exigence patronale qu’elles ne soient pas mariées et encore moins mères célibataires. Ces quatre cents femmes étaient des « pures pucelles rebelles ».
Betsabé, devenue par son talent oratoire son courage la grande cheffe, la « justice faite femme », la « déesse de la liberté » et d’autres appellations données par les journalistes, a atteint des dimensions colossales, allant jusqu’à être appelée la « Jeanne d’Arc » colombienne. Betsabé, dont la mère, devenue folle, mourut des années plus tard à l’asile, se dressa comme le symbole d’un exploit gigantesque pour l’époque. Elle a ouvert des voies impossibles. Et en tant que femme-flambeau, femme-phare, elle a éclairé les ténèbres dans lesquelles les discours ecclésiaux et ceux des propriétaires d’usine maintenaient les travailleur·ses.
Les filles de Bello, avec leur meneuse indomptable, une sorte de Polycarpe ouvrière, spt montées à l’assaut de l’histoire. Les « esclaves rebelles et hautaines, rescapées du bagne de don Emilio Restrepo » (comme l’écrivait un auteur d’ d’El Luchador), battirent à plate couture les propriétaires de l’entreprise et, en vingt et un jours de grève, arrachèrent des revendications comme celle de chasser de l’usine les « trois contremaîtres esclavagistes » et harceleurs. Il y avait, outre Bestabé d’autres protagonistes, comme Trina Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Teresa Piedrahita… toutes « femmes héroïques et viriles de Bello », comme les qualifia El Espectador.
Après la grève historique des demoiselles, la grève juste et, en particulier, Betsabé Espinal furent rendues invisibles. Sur ces femmes qui ont résisté à être des « douces brebis», l’oubli a longtemps régné. Plus tard, surtout à la fin des années 1970, des traces et des recherches sont apparues et un intérêt inhabituel pour activer la mémoire des femmes qui ont brisé la mise sous tutelle et l’embrigadement des curés.
Il y a des années, j’ai rencontré à Bello une des grévistes, camarade de Bestabé. Elle me raconta alors que cette extraordinaire lideure, dont on ne savait plus grand-chose après la « grève des demoiselles », était morte à Medellin, chez elle, pendue par sa chevelure abondante. C’était une fin héroïque et romantique (c’est ce que je raconte dans mon roman Betsabé y Betsabé, publié par l’UpB et en cours de traduction en français). Mais ça ne s’est pas passé comme ça. La fin fut tragique, mais d’une autre manière.
Je suis récemment passé par la maison où est morte Betsabé Espinal, dans le quartier de Las Palmas, à Medellín. Il ne restait plus que quelques jours avant le 90ème de sa mort accidentelle. Rien dans cette résidence d’angle ne rappelait la légendaire jeune fille qui, à 23 ans, est entrée dans l’histoire. Elle mourut électrocutée par des câbles électriques, le 16 novembre 1932.