Ce texte de la journaliste russe assassinée le 7 octobre 2006 est paru dans le journal Novaya Gazeta en septembre 2005. La version française ci-dessous est extraite du livre “Qu’ai-je fait” publié en 2008 par Buchet Chastel dans une traduction de Galia et Ada Ackermann
Un chien malade nous fait comprendre à quel point l’argent nous rend féroce
 Notre chien est mort l’été dernier, à l’âge de quinze ans. Pour un doberman, notre fidèle Martin était un centenaire. Ce merveilleux animal nous avait fidèlement protégés à l’époque du bordel perestroïkiste, puis à celle du banditisme total intrinsèquement lié à l’accumulation du capital et enfin à celle de l’effondrement actuel des libertés, quand vivre est redevenu dangereux. A lui seul, c’était une foule de garde du corps : il adorait les siens, sentait immédiatement les gens mal intentionnés et ne les laissait pas nous approcher, sans jamais mordre cependant personne. Devant les yeux de Martin, nous nous chamaillions, faisions la paix, devenions intimes, nous séparions. Ce n’était pas toujours beau à voir, mais il nous aimait follement, quoi qu’il arrive…
Notre chien est mort l’été dernier, à l’âge de quinze ans. Pour un doberman, notre fidèle Martin était un centenaire. Ce merveilleux animal nous avait fidèlement protégés à l’époque du bordel perestroïkiste, puis à celle du banditisme total intrinsèquement lié à l’accumulation du capital et enfin à celle de l’effondrement actuel des libertés, quand vivre est redevenu dangereux. A lui seul, c’était une foule de garde du corps : il adorait les siens, sentait immédiatement les gens mal intentionnés et ne les laissait pas nous approcher, sans jamais mordre cependant personne. Devant les yeux de Martin, nous nous chamaillions, faisions la paix, devenions intimes, nous séparions. Ce n’était pas toujours beau à voir, mais il nous aimait follement, quoi qu’il arrive…
Avec sa mort, ce fut le début de nos souffrances, car il s’avéra que Martin était notre drogue dure, notre philtre d’amour, notre source de joie intarissable. Même moribond, il relevait ses paupières, remuait le moignon de sa queue et nous souriait.
Après sa mort, nous hébergeâmes deux chats et un gentil perroquet. On n’avait pas à se plaindre car ce petit monde était bien sympathique, mais chaque soir, en l’absence d’un chien, nous étions comme en manque sentimental.
Mes enfants trouvèrent une belle offre sur Internet. Primo, il s’agissait d’un chiot qui ne ressemblait pas à Martin – pour nous, c’était une question de principe. Secundo, il avait des poils courts, auxquels nous étions habitués. Et tertio, d’après tous les renseignements, les bloodhounds étaient une espèce sympathique, amicale.
Nous nous rendons au chenil. L’éleveuse ne cesse de répéter : “C’est un miracle de chien. Le meilleur de la portée.” Entre-temps, le “meilleur” n’arrête pas de pisser. Mais il est très câlin et fait son numéro de charme : prenez-moi, s’il vous plaît… C’est ce qui nous décide : il nous a trop suppliés. Pour nous rassurer, l’éleveuse nous baratine : “A quatre mois, il a encore le droit de pisser partout.”
A la maison, on donna au chien le nom de Van Gogh. Mais on découvrit rapidement qu’il n’était pas simplement un chien pisseur, mais une véritable machine à produire de l’urine. Et voici ce qui était bizarre : il faisait une flaque dès qu’il voyait un homme. D’accord, on a arrêté d’inviter des hommes à la maison, en espérant que cela allait le rassurer. On n’osait pas non plus élever la voix pour le gronder, ne serait-ce que d’un demi-ton : car cela produisait non pas une flaque, mais une rivière. Et dès qu’il faisait une flaque à la maison, il commençait à se démener, à se cacher et, pis, à laper sa propre urine pour en effacer les traces. Se promener? Van Gogh détestait la rue – tout l’insupportait, et le seul moment joyeux de la promenade était le retour à la maison. Sa queue se dressait et remuait dès que nous franchissions le seuil de chez nous. Notre maison était en passe de devenir sa forteresse qu’il aurait préféré ne jamais quitter.
A la clinique vétérinaire, on nous précisa que le chiot n’avait pas quatre mois, mais cinq au bas mot. Pourquoi l’éleveuse nous avait-elle menti ? On nous l’expliqua : “C’est pour que vous le preniez. Les gens n’aiment pas prendre les chiens adultes, car on leur a déjà appris des choses, et pas toujours les bonnes.”
C’était sûrement vrai pour Van Gogh. En plus, le vétérinaire trouva des calculs urinaires dans sa vessie. Les recherches de lithiase coutèrent douze mille roubles [environ 400 dollars, le salaire mensuel d’Anna]. Les antibiotiques nécessaires pour traiter sa forte inflammation en coûtèrent deux mille de plus. Le médecin nous expliqua qu’une lithiase à un âge aussi bas était due aux terribles économies qu’on fait souvent dans les chenils : les éleveurs donnent à manger n’importe quoi aux chiots en pleine croissance, ce qui provoque un mauvais métabolisme. Car la seule chose qui compte, c’est de vendre rapidement l’animal en embobinant les futurs propriétaires. Et ciao ! Les propriétaires de chenils prétendent aimer les animaux, mais en réalité, ils gâchent les bonnes races. Et c’est irréversible, conclut le vétérinaire.
Ir-ré-ver-sible… C’était la première allusion à ce qui nous attendait. Entre-temps, on s’aperçut que Van Gogh s’accrochait à nous comme à un radeau. Il avait de plus en plus peur de chaque personne qui nous rendait visite. Et cet effroi grandissait littéralement avec lui, tournant à l’obsession. Imaginez le tableau : quelqu’un m’approche dans la rue, et Van Gogh essaie de se cacher derrière mon dos. Un gros clébard aux pattes puissantes ! Il n’aboie pas, il ne hurle pas, il dévisage simplement l’étranger avec une telle horreur qu’on est saisi d’horreur soi-même.
Nous finîmes par comprendre : il avait peur qu’on le ramasse. Et dans le passé, c’était des hommes qui l’avaient déjà ramassé. Les hommes étaient devenus ses ennemis. De façon ir-ré-ver-sible.
Le tableau se clarifiait : nous avions pris un chien avec des problèmes psychiques sérieux. Quoi de pire ? Au lieu de protecteur, nous avions un assisté.
Je passe un coup de fil à l’éleveuse : quel est le passé du chien ? Je n’appelle pas pour des réclamations, mais pour aider l’animal. Et l’éleveuse cède : avant nous, on l’avait pris deux fois puis rendu. Elle n’est pas au courant des circonstances exactes, mais on l’a battu, c’est certain. On l’a effrayé. Puis rejeté.

On décida alors de chercher des psychologues et des dresseurs qui travaillent avec des chiens de façon individuelle. Sur le marché des psychologues pour animaux, on ne trouva rien à moins de cinquante dollars la visite. A ce prix, on pouvait obtenir un conseil pour des situations particulières : vacances, sortie à la campagne, changement d’appartement, de ville, de pays… On ne donnait pas plus d’un conseil à la fois pour le prix affiché.
Hélas ! ce service nous était interdit pour de basses raisons matérielles. Impossible.
On se rua vers des dresseurs professionnels. Katia de la société “Chien sage” (ou peut-être “Bon ami”), qui faisait bon poids avec cinq cents roubles l’heure, nous informa qu’elle travaillait uniquement avec les “chiens de l’élite” (il ne s’agissait pas de chiens de race, mais d’animaux appartenant aux gens riches) et qu’elle affichait complet. Néanmoins, elle finit par nous fixer une séance à sept heures du matin. Elle arriva ensommeillée, mais se mit à me donner des ordres : va ici, fais ceci. Ses instructions n’avaient rien d’élitiste : elle répétait le B.A-BA d’un dressage ordinaire.
Un quart d’heure avant la fin de la séance, Katia, malgré sa tenue plutôt altermondialiste – pulle noir, grosses baskets, bandana – exigea, de façon tout à fait capitaliste, qu’on lui paie les cinq cents roubles. Lorsque je remarquai qu’elle était censée travailler encore un quart d’heure avec le chien, elle fit juste une moue méprisante. Nous ne nous sommes plus revues. Pour quoi faire ?
La deuxième puis la troisième dresseuse personnelle furent en tout point identiques à la première, mais à un tarif plus élevé : sept cents et neuf cents roubles pour une heure tronquée.
On ne pouvait continuer à jeter l’argent par les fenêtres, d’autant plus que la vessie de Van Gogh coûtaient des milliers de roubles. Et la vie continua comme avant. Van Gogh avait une peur panique de tout, et je le protégeais. Je le protégeais des hommes, des objets inconnus, des grincements de portes de garage dans la cour, et de nouveau, des hommes…
Au fur et à mesure qu’il devenait adulte, les problèmes s’accumulaient. Pour parvenir jusqu’à un terrain pour chiens près de chez nous, il nous fallait emprunter un passage clouté, sans feux, en évitant de justesse les voitures qui n’ont pas l’habitude de ralentir. À l’approche du passage, Van Gogh tombait de panique sur ses quatre pattes, et je le tirais comme un traîneau – ses quarante ou cinquante kilos de masse faisant résistance – entre les automobiles. Un aller-retour sur le passage clouté, et ma tension faisait un sacré bond. Mais un chien avec un mauvais métabolisme, une lithiase et des problèmes de socialisation se doit de se promener parmi ses semblables !
En fin de compte, je décide de transporter Van Gogh dans ma voiture. Sur le terrain, il court peureusement parmi les autres chiens, mais il joue parfois avec eux. Il bouge, il renifle, il s’habitue. Cependant, la plupart du temps, il reste près de la palissade et regarde notre bagnole avec angoisse. Dès que j’ouvre la portière, il saute vivement sur le siège arrière. Il adore se déplacer et même rester assis dans la voiture. Ce petit espace clos – où il est préservé du monde et se retrouve tête à tête avec sa propriétaire – est son territoire le plus confortable. Il se calme aussitôt, contemple avec plaisir le monde extérieur, presse ses oreilles contre la vitre et peut même s’endormir – toutes ses craintes sont derrière lui. A l’arrivée, il saute de la voiture et se précipite dans le hall de l’immeuble, vers l’ascenseur, vers l’appartement. Tout va bien : ma maison est son bastion.
Ma tension se normalise. Alors que faire de lui ?
Les vétérinaires me le disent droit dans les yeux : il faut l’euthanasier. Mes amis ne sont pas en reste : pourquoi souffrir ? Le chien n’est pas un humain… Donne-le quelque part… Mais c’est encore le discours évasif de l’intelligentsia. Au fond, cela revient à l’euthanasier. Car qui va s’occuper de ce chien hormis ceux qui se sont déjà attachés à cette créature aux longues oreilles et aux yeux tristes et qui n’est coupable de rien ?
Le monde devenu cruel à l’égard des invalides (handicapés, orphelins, malades), l’est aussi à l’égard des animaux. C’est naturel, cela ne peut être autrement. Lorsque tu as un chien malade au bout de la laisse, tu comprends à quel point l’odeur de l’argent nous a rendus féroces.
Je n’appartiens pas au club des cynophiles extrémistes qui préfèrent les chiens aux gens. Moi, quoi qu’il arrive, j’aime les gens plus que les chiens. Mais je ne sais pas abandonner. Et surtout, je ne puis abandonner un être vivant qui ne survivra pas à une nouvelle trahison. Sans moi, il mourra. Il est entièrement en mon pouvoir, jusqu’au dernier poil de sa longue oreille soyeuse. De même qu’il aurait été sous la coupe de n’importe quel autre maître. C’est le monde des riches qui engendre la caste de plus en plus nombreuse des chiens abandonnés. Ils achètent des Van Gogh comme des jouets – on a joué, on n’a pas aimé, on lui a donné un coup de pied -. Qu’il s’estime heureux qu’on le rende au chenil au lieu de le jeter dans la rue. Ces gens ne sentent ni la valeur de l’argent, ni celle d’une âme vivante qui se livre entièrement à eux.
Certes les gens riches ne sont pas tous mauvais, certes, les vétérinaires ne sont pas tous des profiteurs. Mais comment se fait-il que des meutes entières de chiens de race rôdent dans des cours d’immeubles moscovites ?
C’est de nouveau le soir. Je tourne la clé dans la porte, et Van Gogh se jette vers moi. Même s’il a mal au ventre, même s’il est en plein sommeil, même s’il est en train de manger… La source d’une joie intarissable. Tout le monde peut t’abandonner, se fâcher contre toi – le chien, lui, ne cessera pas de t’aimer.
Je le prends, je l’amène vers la voiture pour aller au terrain, je saute près de lui pour qu’il se mette à sauter avec d’autres chiens, je lui montre comment jouer avec eux. Je fais avec lui une course d’obstacles pour l’aider à combattre sa peur, je l’entraîne vers d’autres hommes, je prends leur main pour caresser les oreilles de Van Gogh et je le rassure : tu n’as pas à craindre cette main, mon chien…
NdT
Après la mort d’Anna, Van Gogh a continué de vivre avec ses enfants. Sa santé s’est rétablie, mais il reste peureux.
Anna Politkovskaya Анна Политковская (1958-2006)
Source: Tlaxcala, le 4 octobre 2020

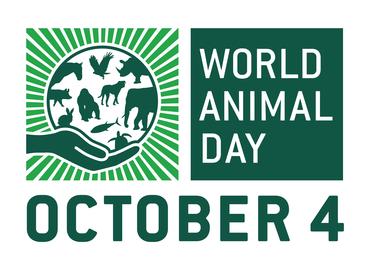
 Anna Politkovskaya Анна Политковская (1958-2006)
Anna Stepanovna Politkóvskaya, nacida el 30 de agosto de 1958 en Nueva York, donde sus padres eran diplomáticos soviéticos de nacionalidad ucraniana, murió asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú. Era una periodista rusa y activista de los derechos humanos conocida por su oposición a la política del presidente ruso Vladimir Putin, su cobertura del conflicto checheno para el periódico Novaya Gazeta y sus críticas virulentas al régimen de Ramzan Kadyrov.
Anna Politkovskaya Анна Политковская (1958-2006)
Anna Stepanovna Politkóvskaya, nacida el 30 de agosto de 1958 en Nueva York, donde sus padres eran diplomáticos soviéticos de nacionalidad ucraniana, murió asesinada el 7 de octubre de 2006 en Moscú. Era una periodista rusa y activista de los derechos humanos conocida por su oposición a la política del presidente ruso Vladimir Putin, su cobertura del conflicto checheno para el periódico Novaya Gazeta y sus críticas virulentas al régimen de Ramzan Kadyrov.