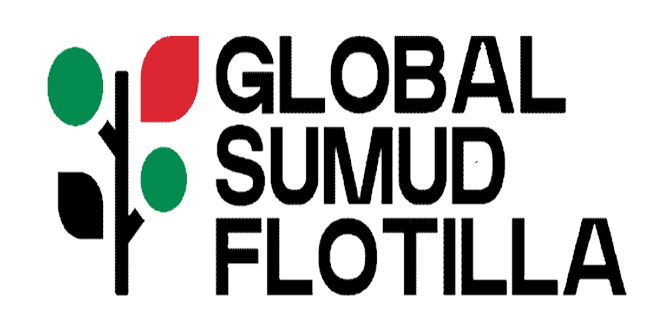Il y a quelques mois, le Madleen était intercepté par l’armée israélienne à quelques kilomètres des côtes de Gaza. Ce 31 août, c’est une flottille de plusieurs dizaines de bateaux qui s’embarque sur la méditerranée dans l’espoir de briser le blocus qui enserre, affame et génocide Gaza. Les esprits les plus réalistes qui sont aussi les plus cyniques, y voient une tentative vaine ou insensée étant donné la puissance sur laquelle les voiliers ne peuvent que se fracasser. Dans cet excellent texte, l’auteur et réalisateur Sylvain George démontre et défend l’exact inverse. Ce qui se joue dans cette flottille, c’est un déplacement de nos repères politiques ; l’inachèvement comme chemin, la vulnérabilité et l’obstination comme puissance, la fragmentation comme forme.-lundimatin
Introduction : De l’événement singulier à la chaîne inachevée
En juin dernier, le départ du Madleen a été pensé comme l’invention d’une forme politique singulière : celle de l’inachèvement. [1]
À travers ce geste, fragile et interrompu, s’ouvrait la possibilité d’une politique qui n’est pas celle de l’accomplissement souverain, de l’acte définitif ou de la victoire éclatante, mais celle du fragment, du recommencement, de l’exposition. Le bateau, empêché d’atteindre Gaza, portait néanmoins une charge symbolique et matérielle irréductible : il inscrivait dans le réel un geste de désobéissance maritime, une brèche dans l’ordre établi, une image qui ne se referme pas.
Il faut cependant rappeler que le Madleen n’était pas une première et venait après une série de tentatives, depuis la fin des années 2000, pour briser le blocus. Mais son mérite fut d’avoir su réactiver l’attention publique, de jeter une lumière crue sur Gaza, et de montrer qu’il est encore possible de produire une image dissidente dans un monde saturé de consentement et de complicité. Car si le bateau fut empêché, il porta dans l’espace international la preuve qu’un geste mineur, vulnérable, pouvait encore fissurer la clôture symbolique du siège.

Or, voici que peu après le Madleen, et le Handala en juillet 2025, une nouvelle flottille a pris la mer, dimanche 31 août 2025, avec plusieurs bateaux cette fois-ci, la « Global Sumud Flotilla », qui entend marquer une inflexion décisive, et tenter une fois encore de briser le blocus. Cette fois, Israël n’aura pas à intercepter un navire isolé, mais à faire face à une flotte entière. La coalition d’associations (Freedom Flotilla, Global March to Gaza, Caravane Soumoud), renforcée par la présence de figures internationales et de milliers de volontaires issus de 160 nationalités, affirme vouloir lancer « la plus grande mission maritime humanitaire de l’histoire » [2]
C’est donc une flotte plurielle, hétérogène, composée de militants, de médecins, d’artistes et de « personnes ordinaires », qui prend la mer pour affronter l’horizon du siège.
La question qui s’impose est alors la suivante : comment penser philosophiquement ce nouveau départ ? S’agit-il d’une simple répétition du même, d’une continuation linéaire, ou bien d’un déplacement qui transforme la signification de l’acte ? Si le premier bateau pouvait apparaître comme un événement ponctuel, à la fois héroïque et vulnérable, le fait que d’autres suivent engage un autre régime de temporalité et de pensée : celui d’une politique de la persistance – non pas une persistance fondée sur une essence immuable, mais une reprise discontinue, fragmentaire, où chaque échec appelle une relance, ou la répétition engendre la différence et non l’identité – du recommencement, de la chaîne inachevée.
On pourrait être tenté de réduire ces flottilles à des échecs tactiques : chaque navire est intercepté, confisqué, empêché. Mais précisément, c’est dans cet empêchement même que réside leur force. Car l’inachèvement n’est pas ici un défaut contingent, mais devient la condition de possibilité de la répétition. Ce qui ne s’accomplit pas une fois peut se rejouer autrement, sous une autre forme, dans une autre constellation. Ce qui échoue à se clore renaît comme fragment, exposé à la saisie, mais aussi à la réinscription.
Ainsi, le geste des flottilles ne relève pas du paradigme de l’événement unique, celui qui, dans sa fulgurance, bouleverserait l’ordre établi. Il s’agit plutôt d’une série discontinue d’actes fragiles, chacun voué à l’inachèvement, mais qui composent ensemble une écriture politique au long cours. Chaque bateau est une feuille arrachée d’un livre inachevé, une image fragmentaire qui persiste. C’est là que se dessine une problématique : comment penser une action politique dont la puissance ne réside pas dans l’accomplissement, mais dans la réitération ? Comment concevoir une politique qui assume de n’être pas un « grand événement » mais une suite de gestes mineurs, intermittents, mais insistants ?
Cette problématique prend toute sa gravité si l’on rappelle ce vers quoi naviguent ces navires : un territoire transformé en camp à ciel ouvert, où l’affamement [3] est devenu méthode de gouvernement, où se déploie sous nos yeux une épuration ethnique méthodique, couverte par la complicité occidentale et arabe, et par le consentement établi de la plupart des nations. Dès lors, la question abyssale se pose : que signifie le départ de quelques bateaux – ou même de dizaines de navires – face à un génocide ?
En ce sens, la « Global Sumud Flotilla » n’est pas simplement la continuation de la précédente. Elle marque une inflexion : le passage du geste isolé au devenir-flottille, c’est-à-dire à une politique qui trouve sa force dans la répétition, dans le fait de rouvrir sans cesse la plaie du blocus, dans le refus obstiné de la clôture. Là où Israël vise à normaliser l’exception, à naturaliser le blocus comme horizon indépassable, la flottille vient rouvrir le temps, raviver l’intolérable, inscrire une temporalité insurgée.
C’est ce passage qu’il s’agit d’analyser : du Madleen, qui a su raviver la lumière sur Gaza en actualisant la force de l’inachèvement, à la nouvelle flottille comme politique de la persistance, comme hétérotopie fragile face au camp, comme écriture fragmentaire qui ne cesse de se réinscrire malgré l’empêchement.